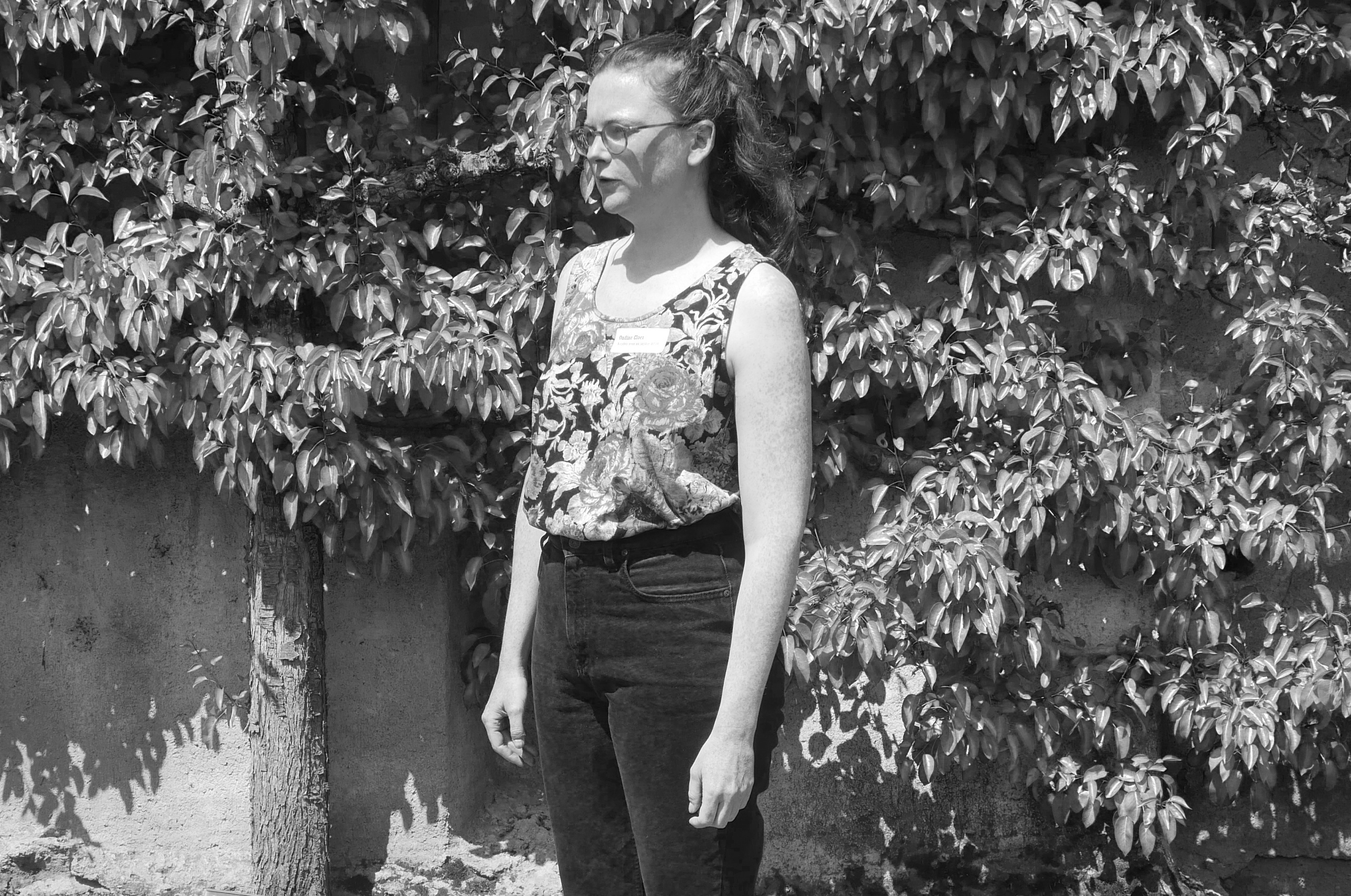
Portraits d’été : Ondine Cloez
Propos recueillis par Wilson Le Personnic
Publié le 19 juillet 2019
Pour certains, l’été est synonyme de repos, pour d’autres, il bat au rythme des festivals. Quoi qu’il en soit, cette période constitue souvent un moment privilégié pour prendre du recul, faire le point sur la saison écoulée et préparer celle qui s’annonce. Nous avons choisi de mettre à profit cette respiration estivale pour aller à la rencontre des artistes qui font vibrer le spectacle vivant. Artistes confirmés ou talents émergents, ils et elles ont accepté de se raconter à travers une série de portraits en questions-réponses. Cette semaine, rencontre avec Ondine Cloez.
Quels sont tes premiers souvenirs de danse ?
Mes souvenirs de danse les plus anciens sont assez flous. Quand je pense aux premiers cours, je n’ai pas d’image nette de ce qu’on faisait. Ce qui me revient, ce sont des sensations : l’odeur du justaucorps neuf dans les vestiaires, les amitiés tissées entre deux cours, le son du piano, la texture de la colophane, la barre en bois. Mais très peu de souvenirs précis des mouvements. Je me suis attachée au mouvement en observant les autres. Je regardais mes camarades, je comparais la manière dont elles portaient leurs bras, leurs mains, comment elles posaient leurs pieds, ou la vitesse de leurs têtes dans les pirouettes. Ce n’était pas tant ce qu’on faisait que comment on le faisait qui m’intéressait. Ces souvenirs-là sont plus clairs. Je revois très bien leurs corps d’enfants au travail, la concentration dans leurs gestes, même si je ne me souviens pas des gestes en eux-mêmes.
Qu’est-ce qui t’a donné envie de devenir chorégraphe ?
J’ai été interprète pendant quinze ans avant de créer ma première pièce, Vacances vacance. J’ai eu envie, à un moment, de la terminer, d’aller jusqu’au bout, et donc je suis devenue chorégraphe. J’étais curieuse de comprendre ce que signifiait créer une pièce depuis l’intérieur, depuis le point de vue de celle ou celui qui décide. Finalement, être chorégraphe n’a pas changé fondamentalement ma manière de travailler. J’ai simplement changé de perspective, pas de pratique. J’ai toujours collaboré avec des chorégraphes impliquant les interprètes dans le processus. On inventait ensemble, même si chacun avait des responsabilités différentes. En créant Vacances vacance, j’ai été surprise de ne pas être déroutée. J’étais en terrain inconnu et pourtant tout me paraissait familier.
Quelle danse as-tu envie de défendre en tant que chorégraphe ?
Yvonne Rainer disait : « Dance is hard to see. » J’aime beaucoup cette phrase parce qu’elle ouvre deux possibles. Soit la danse est difficile à voir et il faut alors inventer des contextes qui la rendent plus visible. Soit cette difficulté est une richesse en soi : elle invite notre regard à se déplacer, à interroger ce qu’il voit et ne voit pas. Ces deux options m’intéressent. J’ai aussi envie de défendre les pièces fragiles, celles qui ont à peine le temps d’exister, qui jouent une ou cinq fois puis disparaissent. Elles sont souvent déterminantes, même dans leur fugacité. Beaucoup de projets que j’ai vus ou vécus comme interprète ont profondément influencé mon regard.
En tant que spectatrice, qu’attends-tu de la danse ? Quels spectacles t’ont marquée ?
J’attends d’un spectacle qu’il me déroute. Qu’il remette en jeu mes repères, mon idée de ce que peut être une performance. En 2006, au Kunstenfestivaldesarts, j’ai vu Invisible Dances de Bock & Vincenzi. Je n’ai jamais su exactement ce que j’ai vu. J’oubliais au fur et à mesure ce que j’étais en train de regarder. C’était là, puis plus là. À la fin, mon ami Randy Carreño et moi nous sommes regardés et, si on avait connu la phrase, on aurait dit comme Grand Magasin : « J’ai tout vu, je n’ai rien compris mais j’ai beaucoup aimé. » En écrivant ça, je réalise que le spectacle s’appelait Invisible Dances. Je l’ai sûrement su, puis oublié plusieurs fois. Il y a quelques mois, une amie m’a offert le livre Invisible Dances … from afar, le projet précédent de Bock & Vincenzi. C’était un spectacle unique à Londres en 2003, joué pour trois personnes : une spectatrice, un médium et un témoin. Le livre rassemble leurs trois témoignages. J’ai été très émue par cette œuvre, par le lien entre mon souvenir flou et ces récits subjectifs. Randy a disparu depuis. Peut-être que ce spectacle est devenu aussi un souvenir partagé avec lui, un lieu d’absence, une énigme douce.
Quels sont, pour toi, les enjeux de la danse aujourd’hui ?
Je pense que le milieu de la danse contemporaine gagnerait à se préoccuper davantage d’éthique. On entend beaucoup de récits d’abus de pouvoir. Ceux qui ont le pouvoir se remettent rarement en question. Bien sûr, ces abus sont plus visibles pour celles et ceux qui les subissent. Mais je crois qu’on travaille mieux dans un environnement sain. L’art ne peut pas tout justifier. J’ai eu un parcours assez protégé, j’ai rencontré peu de situations abusives, et encore, c’est arrivé tard. Mais plus j’en parle avec mes collègues, plus je réalise que j’ai eu de la chance. Les situations que j’ai vécues, qui me semblaient isolées, sont en réalité courantes. Ce n’est pas marginal, c’est structurel. Et cela dépasse la relation chorégraphe-interprète : écoles, institutions, compagnies… La discussion s’ouvre, notamment en Belgique grâce à Engagement côté flamand, et en France grâce à La Permanence. Il faut formuler ces problèmes, les rendre audibles, créer des espaces où les récits personnels deviennent enjeux collectifs.
Quel rôle un artiste doit-il jouer dans la société aujourd’hui ?
Je ne sais pas quel rôle un artiste doit jouer. Peut-être le même que tout le monde, ce serait déjà beaucoup. Je pense que certains excès viennent de l’idée que l’artiste serait une personne à part, hors norme, presque hors la loi. On le voit comme un génie, un être inspiré. Cette vision romantique va de pair avec celle de la souffrance comme moteur créatif. Je suis souvent surprise d’entendre dire que l’on apprend mieux en souffrant. Même chez des pédagogues. Non seulement c’est faux, mais c’est dangereux. Cela justifie les dérives, légitime des comportements autoritaires. L’artiste pourrait plutôt inventer de nouvelles manières de travailler, adaptées au moment. Remettre en question cette idée que souffrir est nécessaire à la création, ouvrir d’autres imaginaires. Il y a plein de méthodes encore inconnues, des zones de travail à découvrir, des façons inédites d’aborder l’art et la création.
Comment imagines-tu la place de la danse dans l’avenir ?
Je pense que la danse fera de la place à d’autres corps, qu’elle se délestera de certains critères encombrants : obsession de la jeunesse, corps lisses, performants, beauté normée, virtuosité. Tous ces idéaux esthétiques qui disent beaucoup sans le vouloir. Il y a encore tant de manières d’habiter un plateau que nous ne soupçonnons pas. La danse de demain sera peut-être celle que je ne peux pas imaginer aujourd’hui, mais qui me déplacera. On inventera d’autres lieux que le théâtre. Ou on transformera des lieux existants en espaces chorégraphiques. J’espère voir plus de spectacles comme Invisible Dances. Je ne suis pas inquiète pour la danse. Tant qu’on aura un corps, on aura de l’empathie pour les autres corps que nous voyons.
Photo far° Nyon

Pol Pi : Dialoguer avec Dore Hoyer
Entretien

De Beyoncé à Maya Deren : la scène comme machine à rêver
Entretien

Jonas Chéreau, Temps de Baleine
Entretien

Betty Tchomanga, Histoire(s) décoloniale(s)
Entretien

Marion Muzac, Le Petit B
Entretien

We Are Still Watching : le théâtre entre les mains du public
Entretien

Amanda Piña : Danser contre l’effacement de l’histoire
Entretien

Old Masters : Faire maison commune avec l’imaginaire
Entretien

Georges Labbat, Self/Unnamed
Entretien

Bouchra Ouizguen, Éléphant
Entretien