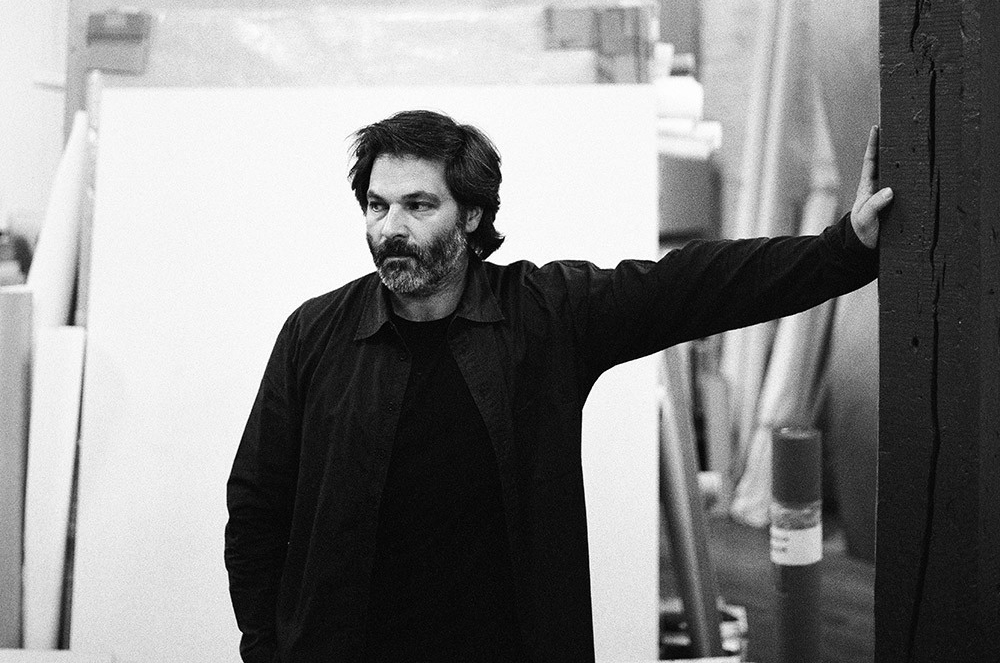
Jocelyn Cottencin « J’ai une longue histoire avec la danse »
Propos recueillis par Wilson Le Personnic
Publié le 15 février 2017
Artiste aux multiples casquettes, Jocelyn Cottencin a présenté l’automne dernier Monumental au Théâtre de la Cité internationale dans le cadre du programme New Settings de Fondation d’entreprise Hermès. Il revient aujourd’hui au Centre National de la Danse à Pantin avec une exposition intitulée A Taxi Driver, an Architect and the High Line, co-signée avec Emmanuelle Huynh. Il a accepté de revenir avec nous sur son parcours, les enjeux de son travail, et sur sa collaboration avec la chorégraphe Emmanuelle Huynh.
Vous êtes plasticien, graphiste, cinéaste, aujourd’hui chorégraphe.. Qu’ont en commun ses différents média dans votre pratique artistique ?
J’utilise différents matériaux en fonction des projets, selon la nécessité et ce qu’ils me permettent de véhiculer. Le graphisme, le film, l’installation, le chorégraphique sont des vecteurs, des matériaux de transmission au service de chaque projet. Dans Monumental, je ne suis pas chorégraphe, j’utilise le chorégraphique, dans A taxi driver, an architect and the higline, projet réalisé avec Emmanuelle Huynh, je ne suis pas cinéaste, j’utilise le film. Je travaille toujours depuis l’endroit qui est le mien, celui des arts visuels, celui d’une réflexion sur la forme, l’image, le signe, l’espace. Je mets en circulation des formes et je regarde ce qu’elles produisent dans leur capacité à frictionner, dialoguer, se confronter à un contexte, un environnement. J’essaye de construire un travail dans la durée, chaque projet est connecté au suivant, chaque projet s’intègre dans un système mobile, qui me permet de redéfinir régulièrement ma géographie de travail, que je souhaite la plus vivante possible.
De quelle manière avez-vous découvert la danse ?
J’ai une longue histoire avec la danse. Ça a commencé lorsque j’étais étudiant à l’ENSAD à Paris (École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs) au début des années 90. Ce que je voyais dans les galeries ne me nourrissait pas tant que ça, à quelques exceptions près. Je m’alimentais plus par ce que l’on appelle les arts dits « appliqués » ou par la production musicale indépendante, anglaise notamment. Je m’intéressais donc au graphisme, au design, à l’architecture comme modalité d’intervention dans l’espace public. Peut-être un des chocs visuels et artistiques de cette période, c’est l’album de Joy Division avec la pochette de Peter Saville (Unknown Pleasures, 1979, ndlr.) que j’ai découvert en 1989, dix ans après sa parution. Et parallèlement j’étais à l’affut de choses qui pouvait étendre cette réflexion. Le centre Pompidou était un de mes lieux fétiches. J’ai poussé la porte de la grande salle de spectacle au sous-sol. C’était le début des années 90. Ne connaissant rien à la danse, étant un peu comme l’Arapèche dont parle Foucault, je voyais tout sans références ni a priori. Avec des attirances et des répulsions, j’ai construit une culture chorégraphique.
Vous avez longtemps collaboré avec des artistes du champs chorégraphique, comment votre pratique s’est articulée avec ce « médium danse » ?
Ma première « collaboration chorégraphique » s’est faite en 96, avec le chorégraphe Daniel Larrieu et sa pièce Mobile ou le miroir du chateau. Avec quelques danseurs de l’équipe, j’ai réalisé une édition intitulée Autour. Ce livre mettait en parallèle Forme / Mot / Geste, ce fut un projet assez fondateur dans mon parcours. J’ai ensuite collaboré avec le chorégraphe Loïc Touzé pour lequel j’ai réalisé les dispositifs scéniques de toutes ses pièces de 2003 à 2013. Il y a aussi eu un projet important en 2002, J’ai dix orteils, avec Nathalie Collantes, un livre pour les enfants sur la danse, le mouvement. Des collaborations aussi avec différents chorégraphes : Alain Michard, Latifa Laabissi, Yves Noël Genod. Depuis 2008, je dialogue sur différents projets avec Emmanuelle Huynh. Il y a plusieurs paramètres qui m’intéressent dans la danse. Cela permet de réunir dans un espace défini et « préparé », des situations, des contextes, de pouvoir convoquer des formes, des situations et des espaces. Monumental me permet cela. Le studio est un formidable terrain de jeu, et l’espace public aussi. Beaucoup de mes projets se passent ou sollicitent l’espace public.
Qu’est-ce qui vous a motivé à mettre en scène Monumental ? Comment s’est imaginé ce premier « objet vidéo » ?
Monumental, c’est à la fois un mélange de vitesse et de lenteur. Vitesse dans le sens ou j’ai eu un temps assez court pour travailler avec les performers sur la première partie du projet, et lenteur car on peut considérer que c’est une lente décantation de toutes les expériences dans le champ chorégraphique sur les quinze dernières années qui ont conduit à ce travail. J’ai monté le projet dans le cadre d’une proposition du Musée des beaux arts de Calais, du Sainsbury center for visual art à Norwich et le Frac basse Normandie à Caen. Ces trois structures travaillaient sur une saison et une série d’expositions autour d’une thématique commune de la célébration, du Monument. Comme c’est souvent le cas dans ces projets, les trois commissaires, Barbara Forest, Sylvie Froux et Veronica Sekules ont retenu des œuvres déjà existantes et ont demandé à des artistes de réaliser des pièces pour leur projet. Rapidement, j’ai engagé un travail de recherches sur ce qui faisait Monument dans chacune de ces villes. J’ai constitué un ensemble documentaire fait de sculpture, d’architecture, d’œuvres contemporaines, de mémorial, etc. J’ai rapidement posé l’idée de travailler avec un groupe de performers / chorégraphes pour re-engager les monuments. L’idée n’était pas de faire des tableaux vivants pour reproduire des images, mais au contraire de comprendre ce qui était contenu dans l’image pour le re-engager à partir d’un ensemble d’informations connexes. Chaque monument est décrypté selon quatre catégories : le symbolique, le récit, la forme, la figure. Dans le cadre de ce projet d’exposition, je savais que je ne pourrais pas présenter la performance, trop complexe à supporter pour les trois musées. J’ai donc pensé à réaliser un objet visuel, un film de la performance mais en considérant qu’il avait deux formes de présentation de ce travail, le film ou une forme live, la performance. Dans la première période de travail, je ne pouvais me concentrer que sur la version film, les questions relatives à l’aboutissement de la version scénique sont venues après lors d’une résidence au Musée de la danse à Rennes.
La vidéo et le dispositif scénique « live » n’offrent pas les mêmes points de vue. Comment dialoguent ces différents regards ?
Dans ce projet, il n’y a pas de face, c’est un objet sculptural en mouvement. Pour le film, je voulais alterner gros plan et plan large, mais je souhaitais aussi réaliser le film en une prise. Dans le temps de la performance, c’était très important que l’on garde le temps réel. Il n’y a pas de séquences majeures, ni de séquences mineures dans le projet. Cela veut dire qu’il n’y a jamais d’images « finies », il y a toujours de la ruine. Après la séquence d’entrée des performers sur Ty Segall, la partition commence avec Bunker. Bunker c’est une forme toujours compacte, ou il faut combler les vides, occuper les interstices. C’est toujours une construction orientée ou multi orientée, etc. Les performeurs commencent à construire cette forme, puis certains s’en vont. Un deuxième bunker se forme, tandis que quelques performeurs restent dans la construction du premier, etc. Le monument suivant absorbe le précédent ou le précédent contient le suivant. Pour le film, les caméras sont placées dans des angles relativement proche pour qu’aucune ne rentre dans le champ de l’autre. Dans la version scénique, le quadri-frontal s’est imposé, ce dispositif implique qu’il n’a pas qu’un seul point de vue.
Comment s’est déroulé le passage de la vidéo à la scène ?
La version scénique de Monumental a été présentée pour la première fois au centre Pompidou grâce à Serge Laurent (programmateur au service des Spectacles Vivants au Centre Pompidou, ndlr.) qui avait déjà présenté le film en mai 2015 dans le cadre du Nouveau Festival. Lors de cette première présentation, le dispositif quadri frontal s’est affiné, tout comme les lumières, avec la collaboration du concepteur lumière Yannick Fouassier. Monumental c’est tout autant un objet d’arts visuels qui joue avec le chorégraphique, qu’une chorégraphie qui jouerait avec les arts visuels et le sculptural. En le présentant sur un plateau, il y a évidemment le rapport au spectaculaire avec lequel j’avais envie de me confronter. Pour la version scénique, contrairement à la version film, l’entrée sur le plateau était une vraie question : comment ça démarre, comment ça prend ? Lorsque le public arrive sur le plateau, un morceau de musique résonne déjà et la lumière est en plein feu, les gens trouvent leur place autour d’un dispositif scénique au centre. Les performeurs arrivent ensuite les uns après les autres, s’habillent et se déshabillent jusqu’à trouver leur tenue pour entrer sur l’aire de jeu. La musique à fond, la lumière, les performeurs, tout fait signe d’une entrée « spectaculaire ». Cela met en confiance, c’est un cheval de Troie. Je crois que beaucoup de spectacteurs se disent à ce moment là « Ok, j’ai compris, ça va envoyer pendant une heure. » Et puis la musique s’arrête, il y a un temps de dépose pour laisser un peu le silence résonner, et la première action démarre. À mon sens, cette séquence d’entrée permet une attention particulière.
La pièce existe en version théâtre et en version musée. Quels sont les enjeux de passer d’un espace à l’autre ?
Le plateau renvoie évidemment davantage à la notion de représentation et le musée à celle d’exposition. Initialement, lorsque la performance est présentée en plateau, j’indique dans la feuille de salle que les spectateurs peuvent se déplacer, mais c’est souvent compliqué car, jusqu’à maintenant, les espaces étaient trop remplis pour que les gens puissent réellement bouger. En revanche, dans le contexte d’un musée, il y a une déambulation possible. Au MAC VAL, Monumental a été présenté dans la salle d’exposition temporaire qui fait plus de 900 m². Cela a permis au public de se comporter presque comme dans un espace d’exposition. Frank Lamy (Chargé des expositions temporaires au Musée d’art contemporain du Val-de-Marne, ndlr.) m’avait demandé aussi de rendre public nos séances de travail le jour qui précédait la performance. Je ne parle pas de répétition, mais de pratique. Ce n’est pas un projet qui se répète, mais qui se travaille via la pratique des formes, des idées, du groupe. J’ai d’ailleurs la chance d’être accompagné depuis le début par des performeurs exceptionnels avec qui je dialogue depuis de nombreuses années. Ce groupe représente en quelque sorte les différentes histoires que j’ai tissé avec la danse.
Vous avez dernièrement co-signé avec la chorégraphe Emmanuelle Huynh une exposition qui s’intitule A Taxi Driver, an Architect and the High Line. Comment cette collaboration est-elle née ?
Avant de commencer à travailler ensemble, je connaissais déjà le travail d’Emmanuelle depuis longtemps. Je l’ai découvert en 96 ou 97, avec une pièce restée à la fois comme un choc et une référence : Múa. Il s’agit d’une pièce hallucinée, qui se déroule dans un noir quasi total. Bizarrement, nous ne nous sommes jamais réellement rencontrés durant ces années 2000, même si nous connaissions beaucoup de personnes en commun. Elle m’a fait intervenir en 2006 au Centre National de Danse Contemporaine (CNDC) d’Angers (qu’elle dirigea de 2004 à 2012, ndlr.) au sein de la formation ESSAI avec Nathalie Collantes, puis quelques années plus tard avec la chorégraphe Jennifer Lacey. Emmanuelle m’a ensuite sollicité pour penser le dispositif scénique de deux de ces pièces, Cribles (en 2009) puis TOZAI !… (en 2014) qui fut un moment de dialogue important entre nous deux. Emmanuelle a ensuite eu une carte blanche autour de l’architecture offre par l’ambassade de France à New-York. Emmanuelle a commencé à travailler sur le rapport des habitants, des corps et de l’environnement. Elle avait fait des repérages et des entretiens, notamment avec Rick et Phil, deux des personnages du film. Elle m’a ensuite contacté pour travailler avec elle sur le projet. Je n’étais pas très intéressé par l’aspect documentaire possible, mais plus à envisager ce projet comme une fiction, comme une performance à l’échelle d’une ville. Nous avons commencé à dialoguer et à concevoir l’écriture du projet ensemble.
Comment s’articule votre pratique avec celle d’Emmanuelle Huynh dans ce projet ?
C’est un travail sur une mémoire de la ville au travers de trois personnages, un chauffeur de taxi, Phil Moore, un architecte Rick Bell et un monument la High Line. Avec les deux premiers, nous avons collecté des mémoires physiques de leur histoire, qui ont été ré-engagés dans la ville, dans le flux de la ville. L’installation est composée de trois films qui n’en font qu’un. La danse – le mouvement – est le vecteur central par lequel s’est construit mon regard cinématographique. Il y a quatre types de mouvement. Ceux que nous mettons dans la ville, les petites actions, performances issues de cette mémoire physique, de l’histoire de la danse aussi. Le mouvement des ouvriers, qui est d’une certaine façon très lié à l’histoire de l’art, comme ces charpentiers qui manipulent une plaque de contre-plaqué, qui font échos – par exemple – aux actions de Robert Morris (artiste et théoricien américain, figure importante du minimalisme, ndlr). Le mouvement des habitants, et enfin, le mouvement de la nature, qui est pour moi une sorte de curseur pour marquer le temps. Le projet est aussi à cet endroit de circulation d’une pratique à une autre, d’une vision à une autre et de ne pas figer les espaces de chacun. Le travail avec Emmanuelle a été assez organique, chacun alimentant depuis son point de vue : Emmanuelle est plus analytique et moi plus empirique, je crois.
J’imagine que la ville de New York a imprégné votre manière de filmer et de regarder la danse. Comment l’architecture dialogue-t-elle ici avec les corps ?
Justement, c’était peut-être une de mes résistances au début du projet. Quand Emmanuelle m’a proposé ce projet, j’avais la sensation que New-York était impossible à filmer, tant elle conditionne déjà une partie de notre imaginaire, notamment cinématographique. On ne découvre pas New York, on valide des images et des situations que l’on a vu dans des films de Woody Allen, de John Cassavetes, de Jim Jarmusch, dans des gros blockbusters ou dans des clips…. Il fallait à mon avis, pour pouvoir filmer dans cette ville, s’en détacher. Je crois que quand j’ai commencé à aborder le rapport à l’image, je me suis intuitivement dit que le fait de travailler sur le corps, le mouvement, de voir la ville au travers ce prisme, pouvait donner une possibilité de la voir autrement, de ne pas la subir. Envisager les mouvements comme des sortes de rituels, que ce soit le geste de l’ouvrier qui tourne autour de son tas de ciment, Phil qui re-joue un trajet qu’il a fait petit pendant une tempête, ou le mouvement du vent dans un buisson, etc. Tous ces temps, tous ces blocs de temps/mouvement donnent un objet visuel qui fonctionne par rebond, par association. On passe d’un bloc de mouvement à autre de bloc de mouvement. Et la ville transparait au travers de ces actions.
Comment s’est construit le montage des différents films ?
Nous avons beaucoup échangé avec Emmanuelle sur le statut de la parole dans le projet et sur le rapport au réel. Le premier film que j’ai monté, c’était celui de Phil. Au début, j’avais réalisé des montages qui était lié à une logique de temps et de récit, ça ne fonctionnait pas. J’ai tout repris sur une composition qui associe des séquences de mouvements à d’autres, d’une façon beaucoup plus intuitive. Ca nous a donné une sorte de trame pour la suite. Nous étions une très petite équipe pour tourner, ce qui fait que chaque action que nous réalisions dans la ville était totalement absorbée par le flux, le contexte. Cette dynamique donne, il me semble, un gout particulier au film et à l’installation. Le contexte absorbe nos actions mais simultanément ces actions deviennent une sorte de référence à partir desquelles on peut voir cet environnement autrement, justement à partir d’une lecture sur le mouvement.
La scénographie de l’exposition invite le regard du spectateur à se déplacer d’une projection vidéo à une autre, comment cette espace s’est-il pensé ?
L’installation est constituée de trois structures en bois faisant référence au billboard, mais qui sont pour moi aussi des éléments entre sculpture et objet fonctionnel. L’espace est conçu comme un lieu où les gens peuvent se déplacer et changer de point de vue, passer à l’arrière des écrans, dans un rapport analogue au déplacement dans un paysage. Il y a aussi des objets, une lampe de chantier, une tour de travaux, des couvertures, une plaque de contreplaqué, une plaque de carton. Tous ces éléments sont rangés, en attente d’être activés pendant la performance, comme des forces en présence.
A Taxi Driver, an Architect and the High Line accueille également une performance éphémère : un duo entre Emmanuelle Huynh et vous. Quels sont les enjeux de faire dialoguer une performance avec cette espace d’exposition ?
Nous avons travaillé le film et l’installation avant d’aborder le projet de la performance. Emmanuelle autant que moi, étions véritablement dans une interrogation sur les modalités de mise en œuvre de cette performance car nous avions déjà eu tous les deux des expériences de spectateurs de projet qui mêlaient danse et image sans que cela soit réellement convainquant. Soit l’image était intéressante et le rapport au corps redondant, ou soit l’inverse. Nous avons cherché à engager la performance en trouvant des modalités de dialogue et de confrontation. Le projet circule de bout en bout sur des questions communes mais avec des approches différentes. Nous avons commencé à imaginer des actions sur le même mode que la construction des films. Il y a aussi une bande-son assez importante, un apport musicale qui devient une autre extension des films. La performance nous permet de continuer ce dialogue à travers la circulation des points de vue et des pratiques. Il n’y a pas d’échelle de valeurs, aucune action n’est plus importante qu’une autre. Il n’y a que des blocs d’actions qui se suivent ou se superposent. Et l’attention passe de l’une à l’autre, parfois des actions se perdent au profit d’une autre.
A Taxi Driver, an Architect and the High Line, au Centre national de la danse à Pantin, du 25 au 31 mars 2017. Entrée libre. Performance le 25 et 26 février dans le cadre du « Week-end Ouverture ». Photo portrait © Pascal Bejean.

Pol Pi, Ecce (H)omo
Entretien

Daphné Biiga Nwanak & Baudouin Woehl, Maya Deren
Entretien

Jonas Chéreau, Temps de Baleine
Entretien

Betty Tchomanga, Histoire(s) décoloniale(s)
Entretien

Marion Muzac, Le Petit B
Entretien

Ivana Müller, We Are Still Watching
Entretien

Amanda Piña, Exótica
Entretien

Old Masters, La Maison de mon esprit
Entretien

Georges Labbat, Self/Unnamed
Entretien

Bouchra Ouizguen, Éléphant
Entretien

Cherish Menzo, D̶A̶R̶K̶MATTER
Entretien

Solène Wachter, For You / Not For You
Entretien

Collectif Foulles, Medieval Crack
Entretien

Hortense Belhôte, Et la marmotte ?
Entretien

Flora Detraz, HURLULA
Entretien

Julian Hetzel & Ntando Cele, SPAfrica
Entretien

Hélène Iratchet, Les Délivrés
Entretien

Michelle Mourra, Lessons for Cadavers
Entretien

Alessandro Sciarroni, Save the last dance for me
Entretien

Silvia Gribaudi, Graces
Entretien